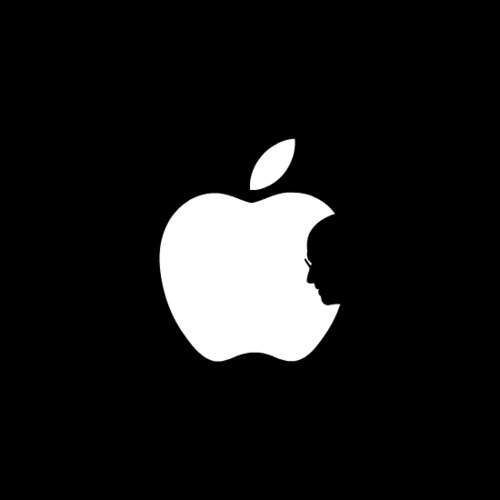02/03/2017
La richesse et la célébrité sont-elles vraiment les plus importantes ?
Lorsqu’on demande à de jeunes adultes quel est le but de leur vie, ils répondent à 80% qu’ils veulent devenir riches, et à 50% qu’ils veulent devenir célèbre également.
Mais est-ce que la richesse et la célébrité sont des facteurs qui peuvent vous rendre heureux et en bonne santé durant toute votre vie ?
Ce n’est pas une question à laquelle il est facile de répondre.
Dans cette vidéo, le psychiatre Robert Waldinger propose néanmoins quelques éléments de réponse.
16:07 Publié dans Conférence, Enseignement, Vidéo | Lien permanent |
|  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
01/11/2011
Comment débattre des nouvelles technologies ?
Surement pas de la façon dont on nous a toujours parlé du Nucléaire.
Surement pas au mépris de la Nature et de ce qui ne se marchande pas !
Quant aux principes, il n’y en a qu’un qui prime “le principe de viabilité”
que je résumerai en ceci :“Dans quelles limites précises ce que nous décidons est viable, pour nous et nos écosystèmes, jusqu’à quel horizon, quel est le prix à payer, par qui, et pour quoi ? - Comment donc privilégier le développement de nos connaissances jusqu’à des niveaux suffisamment fins, et ne pas continuer comme aujourd’hui, à appliquer des connaissances sommaires et mal dégrossies, ou à fabriquer dans nos écoles, nos universités, et nos entreprises des apprentis sorciers dépourvus de tout humanisme voire même humanité comme les barbares qui ont servi le NAZISME. Et donc aussi, comment remettre au service de l’homme, les méthodes qualités qui sont devenus une tarte à la crème qu’on vous jette à la figure pour éviter de parler des contingences réelles ? Regardons le maître incontesté des méthodes “Qualité” copiées par tout le monde occidental, Le JAPON, et son FUKUSHIMA !”.
Le pari est pris que ce Colloque n’ira guère au delà d’une bonne publicité pour Pierre Rosanvallon.
Colloque organisé sur cette question par le Premier Ministre et le Centre d’Analyse stratégique.
Depuis la Révolution française, notre société est confrontée à la perpétuelle redéfinition des relations entre la souveraineté du peuple et le pouvoir du gouvernement représentatif.
Certes, l’essence même de notre démocratie réside dans le vote électoral : il n’en reste pas moins vrai que, comme le montre Pierre Rosanvallon, « une "souveraineté plus active et plus complexe" peut conduire à un gouvernement plus fidèle et plus attentif à la volonté générale, sans nier pour autant la formidable ambigüité qui s’attache à ce dernier terme ».Dans une société que certains disent de plus en plus désenchantée par le politique, mais qui sait se mobiliser lorsqu’elle trouve de l’intérêt aux enjeux qui lui sont soumis, comment notre société peut-elle débattre du développement des technologies et des innovations émergentes, afin d’aboutir à leur développement responsable ? Quels principes doivent nous guider dans l’organisation des concertations correspondantes ?
Quelques références sur le concept de Viabilité en sciences et son étendue :
Jean-Pierre Aubin 1991. Viability Theory
La viabilité
Population Viability Analysis
Evolution of Coalition Structures under Uncertainty
14:58 Publié dans Conférence, Technologies | Lien permanent |
|  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
08/10/2011
En hommage à la mémoire de Steve Jobs – Son discours de 2005 à Stanford .
“Stay Hungry - Stay Foolish”
http://www.freerepublic.com/focus/chat/1422863/posts
Une belle traduction d’Anne DAMOUR publiée en 2005 sur le site lemagchallenges.nouvelobs.com, reprise ce 6/10/2011 ici http://www.challenges.fr/actualite/high-tech/20111006.CHA... :
« C’est un honneur de me trouver parmi vous aujourd’hui et d’assister à une remise de diplômes dans une des universités les plus prestigieuses du monde. Je n’ai jamais terminé mes études supérieures. A dire vrai, je n’ai même jamais été témoin d’une remise de diplômes dans une université. Je veux vous faire partager aujourd’hui trois expériences qui ont marqué ma carrière. C’est tout. Rien d’extraordinaire. Juste trois expériences.
« Pourquoi j’ai eu raison de laisser tomber l’université »
La première concerne les incidences imprévues. J’ai abandonné mes études au Reed Collège au bout de six mois, mais j’y suis resté auditeur libre pendant dix-huit mois avant de laisser tomber définitivement. Pourquoi n’ai-je pas poursuivi ?
Tout a commencé avant ma naissance. Ma mère biologique était une jeune étudiante célibataire, et elle avait choisi de me confier à des parents adoptifs. Elle tenait à me voir entrer dans une famille de diplômés universitaires, et tout avait été prévu pour que je sois adopté dès ma naissance par un avocat et son épouse. Sauf que, lorsque je fis mon apparition, ils décidèrent au dernier moment qu’ils préféraient avoir une fille. Mes parents, qui étaient sur une liste d’attente, reçurent un coup de téléphone au milieu de la nuit : « Nous avons un petit garçon qui n’était pas prévu. Le voulez-vous ? » Ils répondirent : « Bien sûr. » Ma mère biologique découvrit alors que ma mère adoptive n’avait jamais eu le moindre diplôme universitaire, et que mon père n’avait jamais terminé ses études secondaires. Elle refusa de signer les documents définitifs d’adoption et ne s’y résolut que quelques mois plus tard, quand mes parents lui promirent que j’irais à l’université.
Dix-sept ans plus tard, j’entrais donc à l’université. Mais j’avais naïvement choisi un établissement presque aussi cher que Stanford, et toutes les économies de mes parents servirent à payer mes frais de scolarité. Au bout de six mois, je n’en voyais toujours pas la justification. Je n’avais aucune idée de ce que je voulais faire dans la vie et je n’imaginais pas comment l’université pouvait m’aider à trouver ma voie. J’étais là en train de dépenser tout cet argent que mes parents avaient épargné leur vie durant. Je décidai donc de laisser tomber. Une décision plutôt risquée, mais rétrospectivement c’est un des meilleurs choix que j’aie jamais faits. Dès le moment où je renonçais, j’abandonnais les matières obligatoires qui m’ennuyaient pour suivre les cours qui m’intéressaient.
Tout n’était pas rose. Je n’avais pas de chambre dans un foyer, je dormais à même le sol chez des amis. Je ramassais des bouteilles de Coca-Cola pour récupérer le dépôt de 5 cents et acheter de quoi manger, et tous les dimanches soir je faisais 10 kilomètres à pied pour traverser la ville et m’offrir un bon repas au temple de Hare Krishna. Un régal. Et ce que je découvris alors, guidé par ma curiosité et mon intuition, se révéla inestimable à l’avenir. Laissez-moi vous donner un exemple : le Reed Collège dispensait probablement alors le meilleur enseignement de la typographie de tout le pays. Dans le campus, chaque affiche, chaque étiquette sur chaque tiroir était parfaitement calligraphiée. Parce que je n’avais pas à suivre de cours obligatoires, je décidai de m’inscrire en classe de calligraphie. C’est ainsi que j’appris tout ce qui concernait l’empattement des caractères, les espaces entre les différents groupes de lettres, les détails qui font la beauté d’une typographie. C’était un art ancré dans le passé, une subtile esthétique qui échappait à la science. J’étais fasciné.
Rien de tout cela n’était censé avoir le moindre effet pratique dans ma vie. Pourtant, dix ans plus tard, alors que nous concevions le premier Macintosh, cet acquis me revint. Et nous l’incorporâmes dans le Mac. Ce fut le premier ordinateur doté d’une typographie élégante. Si je n’avais pas suivi ces cours à l’université, le Mac ne possèderait pas une telle variété de polices de caractères ni ces espacements proportionnels. Et comme Windows s’est borné à copier le Mac, il est probable qu’aucun ordinateur personnel n’en disposerait. Si je n’avais pas laissé tomber mes études à l’université, je n’aurais jamais appris la calligraphie, et les ordinateurs personnels n’auraient peut-être pas cette richesse de caractères. Naturellement, il était impossible de prévoir ces répercussions quand j’étais à l’université. Mais elles me sont apparues évidentes dix ans plus tard.
On ne peut prévoir l’incidence qu’auront certains évènements dans le futur ; c’est après coup seulement qu’apparaissent les liens. Vous pouvez seulement espérer qu’ils joueront un rôle dans votre avenir. L’essentiel est de croire en quelque chose – votre destin, votre vie, votre karma, peu importe. Cette attitude a toujours marché pour moi, et elle a régi ma vie.
« Pourquoi mon départ forcé d’Apple fut salutaire »
Ma deuxième histoire concerne la passion et l’échec. J’ai eu la chance d’aimer très tôt ce que je faisais. J’avais 20 ans lorsque Woz [Steve Wozniak, le co-fondateur d’Apple N.D.L.R.] et moi avons créé Apple dans le garage de mes parents. Nous avons ensuite travaillé dur et, dix ans plus tard, Apple était une société de plus de 4 000 employés dont le chiffre d’affaires atteignait 2 milliards de dollars. Nous venions de lancer un an plus tôt notre plus belle création, le Macintosh, et je venais d’avoir 30 ans.
C’est alors que je fus viré. Comment peut-on vous virer d’une société que vous avez créée ? C’est bien simple, Apple ayant pris de l’importance, nous avons engagé quelqu’un qui me semblait avoir les compétences nécessaires pour diriger l’entreprise à mes côtés et, pendant la première année, tout se passa bien. Puis nos visions ont divergé, et nous nous sommes brouillés. Le conseil d’administration s’est rangé de son côté. C’est ainsi qu’à 30 ans je me suis retrouvé sur le pavé. Viré avec perte et fracas. La raison d’être de ma vie n’existait plus. J’étais en miettes.
Je restais plusieurs mois sans savoir quoi faire. J’avais l’impression d’avoir trahi la génération qui m’avait précédé – d’avoir laissé tomber le témoin au moment où on me le passait. C’était un échec public, et je songeais même à fuir la Silicon Valley. Puis j’ai peu à peu compris une chose – j’aimais toujours ce que je faisais. Ce qui m’était arrivé chez Apple n’y changeait rien. J’avais été éconduit, mais j’étais toujours amoureux. J’ai alors décidé de repartir de zéro.
Je ne m’en suis pas rendu compte tout de suite, mais mon départ forcé d’Apple fut salutaire. Le poids du succès fit place à la légèreté du débutant, à une vision moins assurée des choses. Une liberté grâce à laquelle je connus l’une des périodes les plus créatives de ma vie.
Pendant les cinq années qui suivirent, j’ai créé une société appelée NeXT et une autre appelée Pixar, et je suis tombé amoureux d’une femme exceptionnelle qui est devenue mon épouse. Pixar, qui allait bientôt produire le premier film d’animation en trois dimensions, Toy Story , est aujourd’hui la première entreprise mondiale utilisant cette technique. Par un remarquable concours de circonstances, Apple a acheté NeXT, je suis retourné chez Apple, et la technologie que nous avions développée chez NeXT est aujourd’hui la clé de la renaissance d’Apple. Et Laurene et moi avons fondé une famille merveilleuse.
Tout cela ne serait pas arrivé si je n’avais pas été viré d’Apple. La potion fut horriblement amère, mais je suppose que le patient en avait besoin. Parfois, la vie vous flanque un bon coup sur la tête. Ne vous laissez pas abattre. Je suis convaincu que c’est mon amour pour ce que je faisais qui m’a permis de continuer. Il faut savoir découvrir ce que l’on aime et qui l’on aime. Le travail occupe une grande partie de l’existence, et la seule manière d’être pleinement satisfait est d’apprécier ce que l’on fait. Sinon, continuez à chercher. Ne baissez pas les bras. C’est comme en amour, vous saurez quand vous aurez trouvé. Et toute relation réussie s’améliore avec le temps. Alors, continuez à chercher jusqu’à ce que vous trouviez.
« Pourquoi la mort est la meilleure chose de la vie »
Ma troisième histoire concerne la mort. A l’âge de 17 ans, j’ai lu une citation qui disait à peu près ceci :
« Si vous vivez chaque jour comme s’il était le dernier, vous finirez un jour par avoir raison. » Elle m’est restée en mémoire et, depuis, pendant les trente-trois années écoulées, je me suis regardé dans la glace le matin en me disant : « Si aujourd’hui était le dernier jour de ma vie, est-ce que j’aimerais faire ce que je vais faire tout à l’heure ? » Et si la réponse est non pendant plusieurs jours à la file, je sais que j’ai besoin de changement.
Avoir en tête que je peux mourir bientôt est ce que j’ai découvert de plus efficace pour m’aider à prendre des décisions importantes. Parce que presque tout – tout ce que l’on attend de l’extérieur, nos vanités et nos fiertés, nos peurs de l’échec – s’efface devant la mort, ne laissant que l’essentiel. Se souvenir que la mort viendra un jour est la meilleure façon d’éviter le piège qui consiste à croire que l’on a quelque chose à perdre. On est déjà nu. Il n’y a aucune raison de ne pas suivre son cœur.
Il y a un an environ, on découvrait que j’avais un cancer. A 7 heures du matin, le scanner montrait que j’étais atteint d’une tumeur au pancréas. Je ne savais même pas ce qu’était le pancréas. Les médecins m’annoncèrent que c’était un cancer probablement incurable, et que j’en avais au maximum pour six mois. Mon docteur me conseilla de rentrer chez moi et de mettre mes affaires en ordre, ce qui signifie : « Préparez-vous à mourir. » Ce qui signifie dire à ses enfants en quelques mois tout ce que vous pensiez leur dire pendant les dix prochaines années. Ce qui signifie essayer de faciliter les choses pour votre famille. En bref, faire vos adieux.
J’ai vécu avec ce diagnostic pendant toute la journée. Plus tard dans la soirée, on m’a fait une biopsie, introduit un endoscope dans le pancréas en passant par l’estomac et l’intestin. J’étais inconscient, mais ma femme, qui était présente, m’a raconté qu’en examinant le prélèvement au microscope, les médecins se sont mis à pleurer, car j’avais une forme très rare de cancer du pancréas, guérissable par la chirurgie. On m’a opéré et je vais bien.
Ce fut mon seul contact avec la mort, et j’espère qu’il le restera pendant encore quelques dizaines d’années. Après cette expérience, je peux vous le dire avec plus de certitude que lorsque la mort n’était pour moi qu’un concept purement intellectuel : personne ne désire mourir. Même ceux qui veulent aller au ciel n’ont pas envie de mourir pour y parvenir. Pourtant, la mort est un destin que nous partageons tous. Personne n’y a jamais échappé. Et c’est bien ainsi, car la mort est probablement ce que la vie a inventé de mieux. C’est le facteur de changement de la vie. Elle nous débarrasse de l’ancien pour faire place au neuf. En ce moment, vous représentez ce qui est neuf, mais un jour vous deviendrez progressivement l’ancien, et vous laisserez la place aux autres. Désolé d’être aussi dramatique, mais c’est la vérité.
Votre temps est limité, ne le gâchez pas en menant une existence qui n’est pas la vôtre. Ne soyez pas prisonnier des dogmes qui obligent à vivre en obéissant à la pensée d’autrui. Ne laissez pas le brouhaha extérieur étouffer votre voix intérieure. Ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. L’un et l’autre savent ce que vous voulez réellement devenir. Le reste est secondaire.
Dans ma jeunesse, il existait une extraordinaire publication The Whole Earth Catalog , l’une des bibles de ma génération. Elle avait été fondée par un certain Stewart Brand, non loin d’ici, à Menlo Park, et il l’avait marquée de sa veine poétique. C’était à la fin des années 1960, avant les ordinateurs et l’édition électronique, et elle était réalisée entièrement avec des machines à écrire, des paires de ciseaux et des appareils Polaroid. C’était une sorte de Google en livre de poche, trente-cinq ans avant la création de Google. Un ouvrage idéaliste, débordant de recettes formidables et d’idées épatantes.
Stewart et son équipe ont publié plusieurs fascicules de The Whole Earth Catalog . Quand ils eurent épuisé la formule, ils sortirent un dernier numéro. C’était au milieu des années 1970, et j’avais votre âge. La quatrième de couverture montrait la photo d’une route de campagne prise au petit matin, le genre de route sur laquelle vous pourriez faire de l’auto-stop si vous avez l’esprit d’aventure. Dessous, on lisait :
« Soyez insatiables. Soyez fous. » C’était leur message d’adieu. Soyez insatiables. Soyez fous. C’est le vœu que j’ai toujours formé pour moi. Et aujourd’hui, au moment où vous recevez votre diplôme qui marque le début d’une nouvelle vie, c’est ce que je vous souhaite.
Soyez insatiables. Soyez fous.
Merci à tous.»
MIDI LIBRE
Extrait de l'article du 6/10/2011 Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Apple sans jamais le demander
Le succès des "i"
Apple aurait vendu plus de 275 millions d'iPods, 100 millions d’iPhone.
Et d'après Apple, il se vendrait un iPad toutes les 3 secondes depuis son lancement.
Le 22 juin 2010, soit 80 jours après son lancement aux États-Unis, Apple annonçait avoir vendu 3 millions d'appareils.
Lors de la Keynote du 2 mars 2011, Apple affirme qu'en 9 mois (période avril-décembre) la société aurait vendu plus de 15 millions de tablettes.
Lors de l'annonce de ses résultats du second trimestre 2011, Apple a indiqué avoir vendu 9,25 millions d'Ipad contre 4,64 millions d'exemplaires au premier trimestre 2011.
17:33 Publié dans Conférence, Hommage, Parcours professionnel, Vidéo | Lien permanent |
|  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
21/11/2010
Qu'est-ce que "savoir" ? Comment être maître de son rapport au monde ?
Vidéo d'une conférence passionnante et d'une grande clarté de Rudolf Bkouche :
Enseigner ou former, la place du savoir dans l'enseignement
On enseigne des savoirs, on forme des individus. D’un côté, le projet issu des Lumières de l’émancipation des hommes, de l’autre, l’adaptation des hommes aux besoins de la société.
La question se pose d’autant plus que, dans la société dite de la connaissance, le savoir est renvoyé aux machines, les hommes n’étant plus que les rouages de la machine économique.
Dans ce cadre, l’université se situe sur une ligne de crête. D’une part, elle reste un lieu de liberté de la pensée, d’autre part, elle est soumise aux normes d’une société réduite à n’être qu’une machine économique. En ce sens, la question de la place des savoirs dans l’enseignement est fondamentale.
Support texte en 2 pages ici
Texte sur les pseudosciences au sein du système d'enseignement ici
12:19 Publié dans Conférence, Enseignement, Technologies, Vidéo | Lien permanent |
|  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
20/07/2010
Rencontres de Pétrarque - Dominique Schnapper « En qui peut-on avoir confiance ? »
Source :
http://www.lemonde.fr/idees/article/2010/07/14/en-qui-peu...
http://www.politique-actu.com/debat/dominique-schnapper/1...
Interviews :
http://publi.franceculture.com/2010-07-16-25emes-rencontr...

Ce texte est extrait de "la leçon inaugurale" que prononcera Dominique Schnapper, lundi 19 juillet, à Montpellier, lors de l'ouverture des Rencontres de Pétrarque, organisées par France Culture et Le Monde dans le cadre du Festival de Radio France.
Ni les pratiques de la vie économique ni la légitimité du politique, c'est-à-dire de l'ordre social, ne pourraient se maintenir s'il n'existait pas un minimum de confiance entre les hommes et si ces derniers n'avaient pas un minimum de confiance dans les institutions.
C'est sur l'établissement de la confiance (outrust en anglais) entre le peuple et l'autorité politique que le philosophe anglais John Locke(1632-1704) faisait reposer le passage de l'état de nature à la société civile. Les rois, les ministres et les assemblées élues n'étaient, pour lui comme pour nous, que les dépositaires de la confiance provisoire que leur avait accordée le peuple. La démocratie, comme l'économie de marché, repose sur la confiance à l'intérieur comme à l'extérieur.
Nous sommes là dans l'idée abstraite de la société démocratique. Mais qu'en est-il aujourd'hui ? Nous serions à l'âge de la "société de défiance généralisée". Et les indicateurs en ce sens ne manquent pas.
Si la confiance semble souvent faire défaut, son érosion est révélatrice de l'une des tensions majeures de l'ordre d'une démocratie, la nôtre, qui est devenue, selon le mot que j'emprunte à Montesquieu, "extrême".
D'un côté, l'individu démocratique, source de la légitimité politique parce qu'il est citoyen, accepte mal de respecter les institutions en tant que telles, il admet difficilement qu'elles doivent être respectées parce qu'elles nous ont été transmises par les générations précédentes. Il admet difficilement que le respect des procédures légales donne leur légitimité aux institutions et aux décisions politiques. L'Homo democraticus entend soumettre les unes et les autres à sa critique. Il se donne le droit de manifester son authenticité et sa personnalité irréductibles à toute autre, donc à tout juger par lui-même. L'argument de la tradition ou de la légalité n'est plus considéré comme légitime.
Les sociologues observent, selon le titre d'un livre de François Dubet, Le Déclin de l'institution (Seuil, 2002), c'est-à-dire de toute institution. Mais, en même temps - c'est la source de cette tension -, le progrès technico-scientifique est si rapide et si brillant qu'il conduit même les savants les plus respectés à être de plus en plus spécialisés. En sorte que l'individu démocratique doit, plus que jamais, s'en remettre à la compétence des autres. Plus que jamais, alors que nous n'accordons pas spontanément d'autorité aux institutions, nous sommes obligés de croire ce que disent les autres, ceux qui savent ou sont censés savoir, et de faire confiance à leur compétence, baptisée dans un terme emprunté à l'anglais "expertise".
Déjà, Tocqueville l'avait pressenti et écrivait dans la seconde partie de la Démocratie en Amérique(1840) : "Il n'y a pas de si grand philosophe qui ne croie un million de choses sur la foi d'autrui et qui ne suppose beaucoup plus de vérités qu'il n'en établit (...) il faut donc toujours, quoi qu'il arrive, que l'autorité se rencontre quelque part dans le monde intellectuel et moral. Sa place est variable mais elle a nécessairement sa place."
Près de deux siècles après, cette analyse reste lumineuse. L'homme démocratique veut soumettre toute vérité et toute décision à sa critique, mais, en même temps, il est condamné à croire non plus "un", mais plusieurs "millions de choses sur la foi d'autrui". Notre autonomie intellectuelle n'a jamais été aussi affirmée, mais, en même temps, nos jugements reposent de plus en plus sur la confiance que nous sommes contraints d'accorder à autrui.
Il ne s'agit pas seulement de la recherche scientifique et de sa spécialisation accrue. Le progrès scientifico-technique rend l'organisation de la vie quotidienne rapidement obsolète et dépasse les capacités de compréhension de la majorité d'entre nous. Le développement de la démocratie providentielle est une autre source de complexité, elle multiplie les catégories et les dispositions législatives et administratives pour tenir compte des cas individuels et des circonstances particulières.
En sorte que nous dépendons plus que jamais étroitement des autres - de ceux qui maîtrisent la technique de nos ordinateurs et de notre déclaration fiscale, de ceux qui peuvent préciser nos droits à obtenir des aides ou des subventions, de ceux qui ont un avis fondé sur l'évolution du climat et sur le destin de la planète ; alors que nous ne cessons d'affirmer notre irréductible individualité et notre droit absolu à l'autonomie intellectuelle.
Contradiction à n'en pas douter. Ou dissonance cognitive pour parler dans les termes de nos savants psychologues sociaux.
Cette tension de l'ordre démocratique permet de comprendre pourquoi, s'agissant du politique, la position du citoyen respectueux des institutions démocratiques légitimes, mais critique - le citoyen est, par définition, critique - reste aussi difficile à maintenir. Nous risquons de céder au plaisir intellectuel de la dénonciation radicale, au nom de notre droit à juger absolument, facile à exercer dans les sociétés libres et souvent rentables dans le monde des intellectuels. La critique raisonnée et raisonnable, qui implique nécessairement la critique de la critique, définit pourtant le citoyen qui soumet librement les décisions prises par son gouvernement à l'épreuve de la raison.
Cela est d'autant plus difficile que la transparence de la vie publique est une exigence démocratique, puisque les gouvernants doivent rester sous le contrôle des citoyens. Or la transparence accrue de la vie politique a son effet pervers, elle a affaibli le caractère sacré du pouvoir qu'entretenait le secret qui entourait le monarque. La transparence, qu'il s'agisse des politiques ou même des grands entrepreneurs ou des grands commis de l'Etat, nourrit plus la méfiance que la confiance. Tous les êtres humains sont faillibles. Il n'est pas sûr qu'en les connaissant mieux on leur fasse une plus grande confiance.
La seule voie qui soit conforme à la vocation de la connaissance scientifique et aux idéaux de la démocratie, la seule à laquelle nous puissions faire une confiance critique, c'est celle de la raison. Elle refuse le relativisme absolu et l'idée que tout se vaut. Elle affirme que la recherche patiente, modeste, fondée sur le travail et la réflexion, permet d'atteindre non pas une vérité transcendantale que nos sociétés laissent à la liberté de chacun, mais des vérités scientifiques, c'est-à-dire partielles et provisoires, qui relèvent du développement de la connaissance rationnelle.
Il existe bien une forme de vérité, celle qui naît de la recherche lente, prudente et cumulative qui finit par entraîner, par corrections successives, l'accord de la majorité des savants. Il est vrai que les combats ne sont jamais définitivement gagnés et que le créationnisme est encore parfois enseigné comme une option scientifique parmi d'autres, mais personne ne prétend plus que la Terre soit plate et immobile.
Plus modestement, les sociologues ont montré, par exemple, qu'il ne suffit pas de mettre en présence des populations différentes pour que les phénomènes d'exclusion et de stigmatisation de l'autre, justifiés par des arguments divers, raciaux, ethniques ou sociaux, s'évanouissent par miracle. Les médecins, de leur côté, ont éradiqué nombre de maladies qui décimaient la population au cours des siècles passés.
Dans tous les cas, la reconnaissance et l'explication de la source des erreurs commises devraient démontrer le sérieux de l'entreprise de connaissance. C'est bien parce que le Groupe d'information sur l'évolution du climat (GIEC) a reconnu avoir fait des erreurs, dont il a expliqué l'origine, qu'il devrait nous inspirer confiance. Les données scientifiques sont falsifiables ou ne sont pas scientifiques.
Dans la société démocratique, scientifique et technique, où la division du travail et la complexité de l'organisation sociale n'ont cessé de croître, chacun est plus que jamais objectivement tributaire de l'activité et des connaissances des autres. La dépendance qui nous unit, aux plus proches comme aux plus lointains, n'a cessé d'augmenter depuis que le philosophe et sociologue allemand Georg Simmel (1858-1918), il y a plus d'un siècle, observait que l'existence de l'homme moderne tenait à cent liaisons, faute desquelles il ne pourrait pas plus continuer à exister que le"membre d'un corps organique qui serait isolé du circuit de la sève".
Jamais l'enchevêtrement des liens entre tous les individus créés par l'universalité des connaissances scientifiques et par l'argent, instrument des échanges économiques, n'a été aussi intense et n'a mis en relation autant de personnes par-delà toutes les frontières. Chacun est de fait condamné à faire confiance à la compétence des autres. Et l'on peut dire qu'en ce sens jamais la confiance n'a autant été au fondement de l'ordre social, national et international.
Mais cette dépendance est objective et abstraite. Si elle n'est pas soutenue par un minimum de confiance subjective, ne risque-t-elle pas de rester formelle ? Non seulement ces liens abstraits ont perdu la saveur et la signification des relations entre les personnes pour les remplacer par les seuls échanges entre des signes, mais le moyen risque toujours de devenir la fin de l'activité des hommes.
La confiance subjective ne suit pas la confiance objective. Les individus démocratiques, qui entendent exercer leur pleine autonomie intellectuelle et juger de tout par eux-mêmes, ne savent plus à qui faire confiance. Ils jugent que leur opinion vaut ce que vaut celle de tous les autres. Tout est opinion, observait déjà Tocqueville. En qui, en quoi avoir confiance ? La confiance subjective ne se décrète pas.
Dominique Schnapper, sociologue, membre du Conseil constitutionnel entre 2001 et 2010
Mot clés : Radio France - dominique schnapper - rencontre - Pétrarque
23:21 Publié dans Conférence | Lien permanent |
|  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |