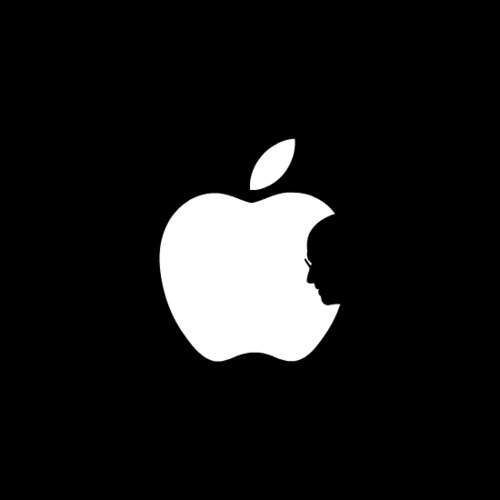09/10/2011
Hommage à la mémoire de Lucien Jerphagnon
Pour la France, l’année 2011 est une année de grands départs …
- Jacqueline de Romilly, académicienne, spécialiste de la civilisation et de la langue grecques
- Christiane Desroches-Noblecourt, première femme égyptologue
- Lucien Jerphagnon, décédé ce 16 septembre 2011.
Retrouvons-le dans cet interview paru en novembre 2010 dans "Philosophie Magazine", suivi d’une courte bibliographie.
Philosophie Magazine - « Je suis un agnostique mystique »
Lucien Jerphagnon se définit comme un « aventurier, un détective » de la pensée antique et médiévale. Enfant, il a fait l'expérience de l'absolu. Depuis, il se sent habité… et toujours en quête. Passionné par l'histoire de la philosophie, ce disciple de Jankélévitch entend la rendre accessible, avec humour si possible.
Propos recueillis par Nicolas Truong / Photos Frédéric Poletti
Il parle de Platon, Plotin ou saint Augustin comme un conteur qui serait des leurs. « Barbouze » de la pensée antique, comme il le dit lui-même, Lucien Jerphagnon sait rendre accessible la plus érudite des sommes théologiques.
Et avec lui, comme à l'époque du Jardin ou du Portique, les dieux ne sont jamais loin. Entre Pierre Dac et Maître Eckhart, l'humour affleure toujours derrière une profondeur.
Professeur émérite des Universités, membre de l'Académie d'Athènes, lauréat de l'Académie française et de l'Académie des sciences morales et politiques, il est un spécialiste incontesté de la pensée grecque et romaine, admiré aussi bien par Michel Onfray que par Luc Ferry. Sans doute en raison de son gai savoir mêlé à son insatiable quête de spiritualité.
Après la Seconde Guerre mondiale, la mode était au marxisme, à l'existentialisme, au structuralisme ou au personnalisme. Mais, plutôt que de rejoindre un nouvel « -isme » ou d'inventer le sien, Lucien Jerphagnon, tel saint Augustin - devant les textes de Plotin, tomba sur les écrits de Vladimir Jankélévitch. Le choc fut immense. Dans un style haletant, celui que ses étudiants appelaient « Janké » attaquait « l'éclat des certitudes inoxydables ».
Lucien Jerphagnon ne cesse depuis de se tenir à distance des« penseurs sachant penser », avec leurs systèmes impérieux et leur prétention à dire le Vrai, pour se consacrer à l'histoire de la pensée.
L'absolu, il en a fait l'expérience à l'âge de 4 ans, lors d'un « Pompéi métaphysique » qui lui fit entrevoir l'étrangeté du monde, la présence du divin et la conviction de ne pouvoir rien en conclure de certain. Rencontre avec un joyeux promeneur érudit.
Philosophie magazine : Comment définiriez-vous votre façon singulière de pratiquer la philosophie ?
Lucien Jerphagnon : Je suis à la fois historien et philosophe. D'un côté, je considérais dans ma jeunesse qu'un philosophe travaillant uniquement sur des concepts était trop éloigné de la quotidienneté. De l'autre, je me disais qu'un historien ne regardant que des batailles, des manuscrits et des traités s'enfermait dans un univers trop distant de l'aujourd'hui. J'ai donc préféré être un historien de la philosophie, c'est-à-dire m'offrir la liberté de respirer l'air du temps et de tous les temps, d'Homère à Jeanne d'Arc, comme dit le sous-titre de mon Histoire de la pensée. Car chaque philosophe ne nous est connu que par le truchement d'autres philosophes. C'est par exemple le platonicien Simplicius qui, au VIe siècle, disputait Aristote, parce qu'il avait mal compris Parménide. J'aime vivre à l'intérieur de ces mondes étrangers, suivre les transmissions de pensées, observer ce qu'elles produisent dans d'autres têtes en explorant l'espace-temps des bibliothèques. Je suis une sorte d'aventurier, de détective, de barbouze de la philosophie antique et médiévale.
Pourquoi ce choix de l'histoire de la philosophie et non pas celui de la création de concepts ?
Les « penseurs sachant penser » m'ont toujours donné l'impression d'être restés dans la caverne de Platon et de n'y avoir écrit que des graffitis. Georges Gusdorf [1912-2000] disait que le rêve de tout philosophe était de mettre fin à la philosophie, parce qu'il voulait dire le dernier mot sur le prétendu « fond » des choses. Ce qui m'intéresse, depuis l'âge de 4 ans, est de répondre à l'invraisemblable question qui ne m'a pas quitté depuis mon enfance, lorsque j'eus l'intuition de la contingence, la révélation de la présence. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? Et puis : que fais-je ici ? Qui suis-je ? Je me tenais dans un bois et je me suis senti tout à coup gorgé d'une présence insolite. Ce fut une éruption philosophique, un Pompéi métaphysique. La philosophie naît de l'étonnement, de l'émerveillement. On le sait au moins depuis Platon et Aristote. Mais celui-ci se prolonge. Comme un amour qui tourne bien. Ainsi je ne me suis jamais habitué à ce qu'il y ait quelque chose plutôt que rien, comme dirait aussi Leibniz. Et je n'ai cessé d'interroger la présence des choses et de moi-même mal défini au milieu des éléments.
Avez-vous retrouvé ces mêmes illuminations dans l'histoire de la philosophie ?
Je n'ai cessé de rencontrer le témoignage de ceux qui ont fait la même expérience. Max Stirner [1806-1856] qui, dans L'Unique et sa propriété, dit : « Ich bin ein Ich » (« Je suis un moi »). Sartre qui, dans La Nausée, met dans la bouche de Roquentin : « Déjà les choses n'avaient pas l'air trop naturel. » Jacques Maritain [1882-1973], qui dans Sept Leçons sur l'être et les premiers principes de la raison spéculative, parle du « déferlement du monde ». Ou bien encore le beau mot de Bergson : « Je ne sais pas encore, mais je pressens que je vais avoir su. » Dès le premier abord, dès le premier étonnement métaphysique qui eut lieu dans ce bois, j'ai su que je ne saurais jamais. C'est pour cette raison qu'il n'y a pas et qu'il n'y aura pas de « jerphagnonisme ». Car je n'ai pas de réponse à cette question.
Quelques années après ce « Pompéi métaphysique », vous avez eu un coup de foudre pour le monde antique alors que vous rêviez sur une gravure lors d'un cours de mathématique… Votre parcours tient-il d'une forme de révélation ?
C'est en tout cas ce que dit la légende ! Je regardais en effet un vieux manuel, type Malet et Isaac. Et puis voici que je tombe sur une reproduction d'un dessin des ruines de Timgad, en Algérie, cette ville romaine qui portait à l'époque le nom de Thamugadi, fondée par l'empereur Trajan en 100 et dotée du statut de colonie, bâtie avec ses temples, ses colonnes, ses thermes, son forum et son grand théâtre… J'ai su que mon âme s'épanouirait là. Puis j'entendis une voix : « Jerphagnon, vous me ferez deux heures de colle ! » Pour quelles raisons m'y suis-je attaché ? Le monde antique m'apparut comme un monde de mots et de choses enchantées, de beauté, d'harmonie et d'énergie. L'esthétique et l'éthique y étaient intimement mêlées. L'exigence de droiture à laquelle les Anciens que je lisais cherchaient à accéder me fascinait. J'ai aimé d'amour ces gens-là. À Rome, je me disais : « Tu regardes le même ciel que regarda Marc-Aurèle ou l'apôtre Paul »…Étonnante histoire : les Romains, qui étaient des bouseux, comme on dirait aujourd'hui, se sont véritablement romanisés en s'hellénisant à l'aide d'un Empire qui fut plus démocratique que la République.
Reprenons une question empruntée à votre collègue et ami Paul Veyne : Grecs et Romains ont-ils cru à leurs mythes ?
Les Romains situaient leurs dieux au ciel, mais ils ne s'attendaient pas pour autant à les y voir ! Ce qui est passionnant chez eux, c'est le rapport perpétuel du philosophique et du mythique. Le mythe n'est jamais loin du raisonnement le plus rationnel. Les dieux ne sont jamais loin. Ils passaient du muthos au logos aussi facilement que nous changeons aujourd'hui de fréquence d'émission de radio. La pensée antique me paraît également rassurante pour ceux dont elle meublait l'intérieur. Elle est efficace, elle semble apporter quelque chose qui transforme l'individu. Regardez le thème de la conversion à la philosophie (conversio ad philosophiam), si présent dans l'Antiquité. Un homme tombe sur un livre, et cela change sa vie, comme le fit Augustin [354-430] lisant l'Hortensius de Cicéron à l'âge de 19 ans. Grâce à un auteur païen, Augustin devient hérétique. La pensée antique vise donc à l'efficacité éthique. Elle donne des recettes de bonheur, développe des attitudes, des pensées, favorise des dispositions qui mènent à la vie heureuse. Combien de De beata vita ont-elles été écrites ? Imaginerait-on aujourd'hui un monarque ou un président écrire, comme Marc-Aurèle, des Pensées pour moi-même ?
Comment s'est effectuée votre propre conversion philosophique ? Quels sont les livres qui ont changé votre façon d'appréhender le monde ?
La découverte de ma vie, ce fut Plotin [205-270], penseur né en Égypte qui, après avoir été découragé par la philosophie, rencontra le maître de vie spirituelle Ammonios Sakkas et eut, lui aussi, la révélation de la vraie philosophie. Selon la Vie qu'écrivit son disciple Porphyre (vers 234-310), Plotin est la manifestation du noûs divin [terme grec, le noûs désigne la partie la plus haute de l'âme]. Si le cosmos est un Tout immanent, la vie émane d'une transcendance, d'un noûs dont procède l'âme du monde. Cette unité, ce « un » est le principe de tout être, il est au-delà de l'Être, mais il ne ressemble pas à
« l'être suprême » des philosophes à venir. Car cette unité est une dualité, puisqu'elle se scinde en sujet et objet pour se penser. J'ai été également sensible à la volonté de Plotin d'être fidèle à Platon par-delà les âges, au point d'envisager d'édifier une ville où l'on suivrait ses principes, Platonopolis.
Dans l'Occident chrétien, une figure prédomine, c'est celle de saint Augustin dont vous avez édité les Œuvres complètes dans « La Bibliothèque de la Pléiade ». En quoi est-il, selon vous, un péda-gogue de dieu ?
Saint Augustin m'a toujours intéressé. Plus que la débauche, son péché est l'arrivisme, à l'image de ces jeunes énarques qui rêvent déjà d'argent, d'honneurs et de décorations. Ce jeune boursier veut arriver. Il veut être quelque chose, au lieu d'être quelqu'un. Il s'aperçoit, en lisant ces livres de Platon, de Plotin ou de Porphyre, que tout cela n'est que vanité. Sa philosophie est une philosophie de la présence. On découvre en effet que Dieu est présent dans l'esprit qui aspire à l'accueillir. Ce sera le thème du Maître intérieur. Saint Augustin a appris à tous les humains présents et à venir cette présence immanente et transcendante de Dieu (in tior, in timo meo), plus intime à mon intimité que je ne le suis moi-même.
La pensée grecque et romaine fait l'objet d'un consensus. Chacun y puise matière à sagesse, de Michel Foucault à Pierre Hadot. Mais la pensée médiévale apparaît toujours comme ténébreuse. En quoi reste-t-elle actuelle ?
Elle est le réveil après un coma intellectuel qui a duré trois siècles. Après la chute de Rome, en 476, l'Occident fut en proie aux invasions barbares. Et, à part Boèce [470-524], il ne resta plus rien de vivant dans la philosophie. Un long hiver de la pensée s'est abattu sur l'Occident. Le Moyen Âge apparaît comme une renaissance de la pensée. Le monde redevient enfin apte à se questionner.
Pourquoi notre monde est-il devenu chrétien ?
Parce que la présence même des chrétiens attestait qu'il y avait un lien possible entre ces gens et l'au-delà. Il semblait rayonner quelque chose d'au-delà de tout. Les anciens n'affectaient pas le concept « dieu » du même coefficient de transcendance que les chrétiens. Il fallait respecter les dieux, mais seulement comme des préfets de régions. Les païens ont trouvé un absolu de dialogue par ce dieu qui s'est fait homme.
Êtes-vous croyant ? Vous affirmez être un « agnostique mystique », qu'entendez-vous par là ?
Je suis axé sur une transcendance qui m'aide à vivre l'immanence. C'est une philosophie d'une bienheureuse espérance. Sallustius dit que « ceux qui se sont bien conduits passeront leur vie avec les dieux ». Même si ce n'est pas le cas, cela vaut le coup de vivre honnêtement. C'est le pari de Pascal. Et je le fais mien. D'autant que cette présence divine serait gâchée si je m'amusais à la définir. C'est un peu comme si je décorais un préfet de région du grade de capitaine des pompiers ! C'est vrai, je suis un agnostique mystique qui croit en quelque chose mais demeure conscient qu'il s'agit d'une croyance. Un agnostique mystique est un apophatique [du grec apophasis : négation, la démarche apophatique se propose de dire ce que Dieu n'est pas, car il est impossible de dire ce qu'il est] qui a compris qu'on ne peut parler de Dieu qu'en projetant sur lui des catégories humaines. Je crois en Dieu, mais je ne peux rien en dire de définitif. Or, hélas, nous faisons Dieu à notre image. Regardez-les, tous ces Torquemada d'hier… et tous ces imbéciles contemporains prêts à envoyer les hérétiques au feu. Je n'ai rien à prêcher. Avoir entrevu l'absolu à 4 ans m'a suffi.
Vous ne cessez d'osciller entre Pierre Dac et Plotin, Raymond Devos et saint Augustin… Est-ce parce qu'il faut prendre le rire au sérieux ou bien parce que rien n'est sérieux ?
Pour un auteur d'ouvrages de philosophie, le principal consiste à croire qu'il déboule tout droit de l'absolu. L'humour crée un décalage alors que le sérieux est pontifical. L'humour conjure la tentation de se prendre au sérieux et d'être pris au sérieux. Dans Le Nom de la Rose d'Umberto Eco, je me sens proche de Guillaume de Baskerville qui lance à Jorge : « Vous êtes le diable, la foi sans sourire, c'est-à-dire la vérité qui n'est jamais effleurée par le doute. » Je me moque d'une métaphysique effrayante par l'impression qu'elle donne d'être lourde. Je voudrais qu'elle soit accessible. Je souhaite que ceux qui me lisent aperçoivent une lumière, découvrent une espérance. Vladimir Jankélévitch [1903-1985] dont je fus l'un des assistants, ne cessait de le pratiquer. Quant on rit, on peut entrevoir. Autrement, on s'arrange pour voir.
Avez-vous conscience de fédérer aussi bien les idéalistes que les matérialistes, de séduire aussi bien Luc Ferry que Michel Onfray ?
C'est curieux, en effet. Michel Onfray a été un de mes étudiants à Caen, au moment où j'enseignais le livre II ou III du De Rerum natura de Lucrèce. J'avais repéré ce jeune homme très attentif et qui ne me quittait pas des yeux, excellent étudiant au demeurant. C'est bien la preuve que je n'engendre pas que des clones ! Ainsi lui ai-je peut-être permis d'être diamétralement opposé à ma vision du monde. D'ailleurs, je disais toujours à mes étudiants : « Ne vous avisez pas de répéter mon cours à l'examen. D'abord parce que je le connais mieux que vous. Ensuite parce que j'espère qu'il vous permettra de découvrir des choses que vous n'auriez pas sues sans lui afin qu'il vous aide à forger votre propre vision du monde. »
Sans certitude, sans système, mais non sans humour… Que cherchez-vous, Lucien Jerphagnon ?
Je cherche à me coucher moins idiot. J'ai horreur de ce qui est fixé, classé, définitif. Comme le dit mon complice Paul Veyne, les idées générales ne sont ni vraies, ni fausses, ni justes, ni injustes, mais creuses. Les penseurs sachant penser m'ennuient. Mais je cherche toujours l'émerveillement. Au milieu d'une franche rigolade, Pierre Dac dit en substance un mot d'une profondeur inouïe, surtout lorsqu'on la rapporte au sort fait aux Juifs pendant cette guerre que j'ai bien connue : « On prétend qu'il n'y a personne là-haut. Regardez les cieux, vous y verrez plein de petites étoiles jaunes… »Rien ne peut mieux résumer « ma » philosophie.
Pour aller plus loin
L'oeuvre de Lucien Jerphagnon
Histoire de la pensée, d'Homère à Jeanne d'Arc (Taillandier, 2009).
L'auteur conte vingt siècles de philosophie occidentale avec une aisance déconcertante et cet incomparable franc-parler (que les Grecs appelaientparrhésia) qui a fait le succès de ses longues années d'enseignement.
Saint Augustin, le pédagogue de Dieu (« Découvertes », Gallimard, 2002).
Articulant vulgarisation érudite et iconographie fournie, l'ouvrage raconte les années d'apprentissage de l'ambitieux jeune homme né dans l'Afrique romaine du IVe siècle jusqu'à sa vocation chrétienne, sans oublier le destin de la philosophie augustinienne.
À lire avant d'aborder l'édition des Œuvres dans la « Pléiade » que Lucien Jerphagnon a dirigée et commentée (Gallimard, 3 volumes, 1998-2002).
Julien dit l'Apostat (1986, Taillandier, 2008).
Une somptueuse biographie intime de l'empereur Julien (331/332-26 juin 363), nommé Julien l'Apostat par la tradition chrétienne. Loin de la réhabilitation apologétique, Lucien Jerphagnon le portraiture en« adolescent prolongé » et met au jour les intrigues de palais. Un « Roman de la rose » antique.
Les Dieux ne sont jamais loin (Desclée de Brouwer, 2003).
La pensée rationnelle n'a pas éradiqué la pensée mythique. Les deux univers n'ont cessé de coexister et l'auteur montre les entrelacs, les interpénétrations incessantes qui font la singularité de la pensée antique.
La Tentation du christianisme (avec Luc Ferry, Grasset, 2009).
Un passionnant dialogue sur la « révolution chrétienne » dans lequel Lucien Jerphagnon s'attache à montrer comment la religion était vécue au quotidien par les Romains afin de comprendre comment notre monde est devenu chrétien.
Lavdator Temporis Acti (« C'était mieux avant », Taillandier, 2007).
Désopilant recueil de citations sur le pessimisme générationnel, de Caton à Camus. À prescrire d'urgence aux apôtres du « tout-fout-le-camp ».
Entrevoir et vouloir. Vladimir Jankélévitch (La Transparence, 2008).
Un hommage à son maître de philosophie, une introduction à l'œuvre du philosophe de l'inachevé, du je-ne-sais-quoi et du presque-rien.
Sur Bibliothèques Médicis, interview de Christine Rancé (vers 8mn40) qui a travaillé ses 2 dernières années avec Lucien Jerphagnon (autre Interview vers 14mn08) et qui nous parle de son dernier livre d'entretiens paru chez Albin Michel : «De l'amour, de la mort, de Dieu et autres bagatelles».
00:14 Publié dans Hommage | Lien permanent |
|  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
08/10/2011
En hommage à la mémoire de Steve Jobs – Son discours de 2005 à Stanford .
“Stay Hungry - Stay Foolish”
http://www.freerepublic.com/focus/chat/1422863/posts
Une belle traduction d’Anne DAMOUR publiée en 2005 sur le site lemagchallenges.nouvelobs.com, reprise ce 6/10/2011 ici http://www.challenges.fr/actualite/high-tech/20111006.CHA... :
« C’est un honneur de me trouver parmi vous aujourd’hui et d’assister à une remise de diplômes dans une des universités les plus prestigieuses du monde. Je n’ai jamais terminé mes études supérieures. A dire vrai, je n’ai même jamais été témoin d’une remise de diplômes dans une université. Je veux vous faire partager aujourd’hui trois expériences qui ont marqué ma carrière. C’est tout. Rien d’extraordinaire. Juste trois expériences.
« Pourquoi j’ai eu raison de laisser tomber l’université »
La première concerne les incidences imprévues. J’ai abandonné mes études au Reed Collège au bout de six mois, mais j’y suis resté auditeur libre pendant dix-huit mois avant de laisser tomber définitivement. Pourquoi n’ai-je pas poursuivi ?
Tout a commencé avant ma naissance. Ma mère biologique était une jeune étudiante célibataire, et elle avait choisi de me confier à des parents adoptifs. Elle tenait à me voir entrer dans une famille de diplômés universitaires, et tout avait été prévu pour que je sois adopté dès ma naissance par un avocat et son épouse. Sauf que, lorsque je fis mon apparition, ils décidèrent au dernier moment qu’ils préféraient avoir une fille. Mes parents, qui étaient sur une liste d’attente, reçurent un coup de téléphone au milieu de la nuit : « Nous avons un petit garçon qui n’était pas prévu. Le voulez-vous ? » Ils répondirent : « Bien sûr. » Ma mère biologique découvrit alors que ma mère adoptive n’avait jamais eu le moindre diplôme universitaire, et que mon père n’avait jamais terminé ses études secondaires. Elle refusa de signer les documents définitifs d’adoption et ne s’y résolut que quelques mois plus tard, quand mes parents lui promirent que j’irais à l’université.
Dix-sept ans plus tard, j’entrais donc à l’université. Mais j’avais naïvement choisi un établissement presque aussi cher que Stanford, et toutes les économies de mes parents servirent à payer mes frais de scolarité. Au bout de six mois, je n’en voyais toujours pas la justification. Je n’avais aucune idée de ce que je voulais faire dans la vie et je n’imaginais pas comment l’université pouvait m’aider à trouver ma voie. J’étais là en train de dépenser tout cet argent que mes parents avaient épargné leur vie durant. Je décidai donc de laisser tomber. Une décision plutôt risquée, mais rétrospectivement c’est un des meilleurs choix que j’aie jamais faits. Dès le moment où je renonçais, j’abandonnais les matières obligatoires qui m’ennuyaient pour suivre les cours qui m’intéressaient.
Tout n’était pas rose. Je n’avais pas de chambre dans un foyer, je dormais à même le sol chez des amis. Je ramassais des bouteilles de Coca-Cola pour récupérer le dépôt de 5 cents et acheter de quoi manger, et tous les dimanches soir je faisais 10 kilomètres à pied pour traverser la ville et m’offrir un bon repas au temple de Hare Krishna. Un régal. Et ce que je découvris alors, guidé par ma curiosité et mon intuition, se révéla inestimable à l’avenir. Laissez-moi vous donner un exemple : le Reed Collège dispensait probablement alors le meilleur enseignement de la typographie de tout le pays. Dans le campus, chaque affiche, chaque étiquette sur chaque tiroir était parfaitement calligraphiée. Parce que je n’avais pas à suivre de cours obligatoires, je décidai de m’inscrire en classe de calligraphie. C’est ainsi que j’appris tout ce qui concernait l’empattement des caractères, les espaces entre les différents groupes de lettres, les détails qui font la beauté d’une typographie. C’était un art ancré dans le passé, une subtile esthétique qui échappait à la science. J’étais fasciné.
Rien de tout cela n’était censé avoir le moindre effet pratique dans ma vie. Pourtant, dix ans plus tard, alors que nous concevions le premier Macintosh, cet acquis me revint. Et nous l’incorporâmes dans le Mac. Ce fut le premier ordinateur doté d’une typographie élégante. Si je n’avais pas suivi ces cours à l’université, le Mac ne possèderait pas une telle variété de polices de caractères ni ces espacements proportionnels. Et comme Windows s’est borné à copier le Mac, il est probable qu’aucun ordinateur personnel n’en disposerait. Si je n’avais pas laissé tomber mes études à l’université, je n’aurais jamais appris la calligraphie, et les ordinateurs personnels n’auraient peut-être pas cette richesse de caractères. Naturellement, il était impossible de prévoir ces répercussions quand j’étais à l’université. Mais elles me sont apparues évidentes dix ans plus tard.
On ne peut prévoir l’incidence qu’auront certains évènements dans le futur ; c’est après coup seulement qu’apparaissent les liens. Vous pouvez seulement espérer qu’ils joueront un rôle dans votre avenir. L’essentiel est de croire en quelque chose – votre destin, votre vie, votre karma, peu importe. Cette attitude a toujours marché pour moi, et elle a régi ma vie.
« Pourquoi mon départ forcé d’Apple fut salutaire »
Ma deuxième histoire concerne la passion et l’échec. J’ai eu la chance d’aimer très tôt ce que je faisais. J’avais 20 ans lorsque Woz [Steve Wozniak, le co-fondateur d’Apple N.D.L.R.] et moi avons créé Apple dans le garage de mes parents. Nous avons ensuite travaillé dur et, dix ans plus tard, Apple était une société de plus de 4 000 employés dont le chiffre d’affaires atteignait 2 milliards de dollars. Nous venions de lancer un an plus tôt notre plus belle création, le Macintosh, et je venais d’avoir 30 ans.
C’est alors que je fus viré. Comment peut-on vous virer d’une société que vous avez créée ? C’est bien simple, Apple ayant pris de l’importance, nous avons engagé quelqu’un qui me semblait avoir les compétences nécessaires pour diriger l’entreprise à mes côtés et, pendant la première année, tout se passa bien. Puis nos visions ont divergé, et nous nous sommes brouillés. Le conseil d’administration s’est rangé de son côté. C’est ainsi qu’à 30 ans je me suis retrouvé sur le pavé. Viré avec perte et fracas. La raison d’être de ma vie n’existait plus. J’étais en miettes.
Je restais plusieurs mois sans savoir quoi faire. J’avais l’impression d’avoir trahi la génération qui m’avait précédé – d’avoir laissé tomber le témoin au moment où on me le passait. C’était un échec public, et je songeais même à fuir la Silicon Valley. Puis j’ai peu à peu compris une chose – j’aimais toujours ce que je faisais. Ce qui m’était arrivé chez Apple n’y changeait rien. J’avais été éconduit, mais j’étais toujours amoureux. J’ai alors décidé de repartir de zéro.
Je ne m’en suis pas rendu compte tout de suite, mais mon départ forcé d’Apple fut salutaire. Le poids du succès fit place à la légèreté du débutant, à une vision moins assurée des choses. Une liberté grâce à laquelle je connus l’une des périodes les plus créatives de ma vie.
Pendant les cinq années qui suivirent, j’ai créé une société appelée NeXT et une autre appelée Pixar, et je suis tombé amoureux d’une femme exceptionnelle qui est devenue mon épouse. Pixar, qui allait bientôt produire le premier film d’animation en trois dimensions, Toy Story , est aujourd’hui la première entreprise mondiale utilisant cette technique. Par un remarquable concours de circonstances, Apple a acheté NeXT, je suis retourné chez Apple, et la technologie que nous avions développée chez NeXT est aujourd’hui la clé de la renaissance d’Apple. Et Laurene et moi avons fondé une famille merveilleuse.
Tout cela ne serait pas arrivé si je n’avais pas été viré d’Apple. La potion fut horriblement amère, mais je suppose que le patient en avait besoin. Parfois, la vie vous flanque un bon coup sur la tête. Ne vous laissez pas abattre. Je suis convaincu que c’est mon amour pour ce que je faisais qui m’a permis de continuer. Il faut savoir découvrir ce que l’on aime et qui l’on aime. Le travail occupe une grande partie de l’existence, et la seule manière d’être pleinement satisfait est d’apprécier ce que l’on fait. Sinon, continuez à chercher. Ne baissez pas les bras. C’est comme en amour, vous saurez quand vous aurez trouvé. Et toute relation réussie s’améliore avec le temps. Alors, continuez à chercher jusqu’à ce que vous trouviez.
« Pourquoi la mort est la meilleure chose de la vie »
Ma troisième histoire concerne la mort. A l’âge de 17 ans, j’ai lu une citation qui disait à peu près ceci :
« Si vous vivez chaque jour comme s’il était le dernier, vous finirez un jour par avoir raison. » Elle m’est restée en mémoire et, depuis, pendant les trente-trois années écoulées, je me suis regardé dans la glace le matin en me disant : « Si aujourd’hui était le dernier jour de ma vie, est-ce que j’aimerais faire ce que je vais faire tout à l’heure ? » Et si la réponse est non pendant plusieurs jours à la file, je sais que j’ai besoin de changement.
Avoir en tête que je peux mourir bientôt est ce que j’ai découvert de plus efficace pour m’aider à prendre des décisions importantes. Parce que presque tout – tout ce que l’on attend de l’extérieur, nos vanités et nos fiertés, nos peurs de l’échec – s’efface devant la mort, ne laissant que l’essentiel. Se souvenir que la mort viendra un jour est la meilleure façon d’éviter le piège qui consiste à croire que l’on a quelque chose à perdre. On est déjà nu. Il n’y a aucune raison de ne pas suivre son cœur.
Il y a un an environ, on découvrait que j’avais un cancer. A 7 heures du matin, le scanner montrait que j’étais atteint d’une tumeur au pancréas. Je ne savais même pas ce qu’était le pancréas. Les médecins m’annoncèrent que c’était un cancer probablement incurable, et que j’en avais au maximum pour six mois. Mon docteur me conseilla de rentrer chez moi et de mettre mes affaires en ordre, ce qui signifie : « Préparez-vous à mourir. » Ce qui signifie dire à ses enfants en quelques mois tout ce que vous pensiez leur dire pendant les dix prochaines années. Ce qui signifie essayer de faciliter les choses pour votre famille. En bref, faire vos adieux.
J’ai vécu avec ce diagnostic pendant toute la journée. Plus tard dans la soirée, on m’a fait une biopsie, introduit un endoscope dans le pancréas en passant par l’estomac et l’intestin. J’étais inconscient, mais ma femme, qui était présente, m’a raconté qu’en examinant le prélèvement au microscope, les médecins se sont mis à pleurer, car j’avais une forme très rare de cancer du pancréas, guérissable par la chirurgie. On m’a opéré et je vais bien.
Ce fut mon seul contact avec la mort, et j’espère qu’il le restera pendant encore quelques dizaines d’années. Après cette expérience, je peux vous le dire avec plus de certitude que lorsque la mort n’était pour moi qu’un concept purement intellectuel : personne ne désire mourir. Même ceux qui veulent aller au ciel n’ont pas envie de mourir pour y parvenir. Pourtant, la mort est un destin que nous partageons tous. Personne n’y a jamais échappé. Et c’est bien ainsi, car la mort est probablement ce que la vie a inventé de mieux. C’est le facteur de changement de la vie. Elle nous débarrasse de l’ancien pour faire place au neuf. En ce moment, vous représentez ce qui est neuf, mais un jour vous deviendrez progressivement l’ancien, et vous laisserez la place aux autres. Désolé d’être aussi dramatique, mais c’est la vérité.
Votre temps est limité, ne le gâchez pas en menant une existence qui n’est pas la vôtre. Ne soyez pas prisonnier des dogmes qui obligent à vivre en obéissant à la pensée d’autrui. Ne laissez pas le brouhaha extérieur étouffer votre voix intérieure. Ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. L’un et l’autre savent ce que vous voulez réellement devenir. Le reste est secondaire.
Dans ma jeunesse, il existait une extraordinaire publication The Whole Earth Catalog , l’une des bibles de ma génération. Elle avait été fondée par un certain Stewart Brand, non loin d’ici, à Menlo Park, et il l’avait marquée de sa veine poétique. C’était à la fin des années 1960, avant les ordinateurs et l’édition électronique, et elle était réalisée entièrement avec des machines à écrire, des paires de ciseaux et des appareils Polaroid. C’était une sorte de Google en livre de poche, trente-cinq ans avant la création de Google. Un ouvrage idéaliste, débordant de recettes formidables et d’idées épatantes.
Stewart et son équipe ont publié plusieurs fascicules de The Whole Earth Catalog . Quand ils eurent épuisé la formule, ils sortirent un dernier numéro. C’était au milieu des années 1970, et j’avais votre âge. La quatrième de couverture montrait la photo d’une route de campagne prise au petit matin, le genre de route sur laquelle vous pourriez faire de l’auto-stop si vous avez l’esprit d’aventure. Dessous, on lisait :
« Soyez insatiables. Soyez fous. » C’était leur message d’adieu. Soyez insatiables. Soyez fous. C’est le vœu que j’ai toujours formé pour moi. Et aujourd’hui, au moment où vous recevez votre diplôme qui marque le début d’une nouvelle vie, c’est ce que je vous souhaite.
Soyez insatiables. Soyez fous.
Merci à tous.»
MIDI LIBRE
Extrait de l'article du 6/10/2011 Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Apple sans jamais le demander
Le succès des "i"
Apple aurait vendu plus de 275 millions d'iPods, 100 millions d’iPhone.
Et d'après Apple, il se vendrait un iPad toutes les 3 secondes depuis son lancement.
Le 22 juin 2010, soit 80 jours après son lancement aux États-Unis, Apple annonçait avoir vendu 3 millions d'appareils.
Lors de la Keynote du 2 mars 2011, Apple affirme qu'en 9 mois (période avril-décembre) la société aurait vendu plus de 15 millions de tablettes.
Lors de l'annonce de ses résultats du second trimestre 2011, Apple a indiqué avoir vendu 9,25 millions d'Ipad contre 4,64 millions d'exemplaires au premier trimestre 2011.
17:33 Publié dans Conférence, Hommage, Parcours professionnel, Vidéo | Lien permanent |
|  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
26/09/2011
C. Jerôme–Kiss me.
http://www.youtube.com/watch?v=mR_CxYlL3FE&feature=pl...
Kiss me, as you love me, prends un coca et assieds-toi
Kiss me, as you love me, ferme les yeux écoute-moi
Ce soir, si tu le veux, dans un grand lit nous serons mieux
J'aimerais te retenir mais en anglais comment le dire
Il y avait un drapeau américain
Sur son sac déchiré
Un blue-jean qui ne valait plus rien
Mais je crois que je l'aimais bien
Kiss me, as you love me, ta cigarette m'énerve un peu
Kiss me, as you love me, tu sais la vie n'est pas un jeu
Demain, au petit jour, nous resterons pour faire l'amour
Un collier rouge et bleu sur ses seins nus
Un foulard en bannière
On voyait un anneau sur ses pieds nus
Prêt à faire le tour de la terre
Kiss me, as you love me, ne t'en vas pas, souris un peu
Kiss me, as you love me, dis-moi good bye mais pas adieu
Il y avait un drapeau américain
Sur son sac déchiré
Un blue-jean qui ne valait plus rien
Mais je crois que je l'aimais bien
Un collier rouge et bleu sur ses seins nus
Un foulard en bannière
On voyait un anneau sur ses pieds nus ...
02:55 Publié dans Chanson, Danse, Musique, Vidéo | Lien permanent |
|  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
20/09/2011
Hollywood, à l’occasion des 40 ans du premier Album de Maxime Le Forestier
http://television.telerama.fr/tele/programmes-tv/maxime-l... (rediffusion le 27/09 à 3h05 sur Fr3)
 Une histoire plus improbable que celle de DSK, des rimes absolument géniales, une musique entrainante, de parfaites harmonies vocales.
Une histoire plus improbable que celle de DSK, des rimes absolument géniales, une musique entrainante, de parfaites harmonies vocales.
Le grand David McNeil est ici accompagné par Alain Souchon, Renaud, Laurent Voulzy, Maxime Le Forestier, Robert Charlebois et Julien Clerc. Régalez-vous!
http://www.youtube.com/watch?v=njWJ3Y0eOmE
HOLLYWOOD
Auteur : David Mac Neil, Interprètes : Yves Montand (France), mais aussi Julien Clerc; David McNeil et toute la clique de l’enregistrement ci-dessus.
Ma mère dansait dans les bars 
Imitant Jean Harlow
Mon père lançait des poignards
Au cirque à Buffalo
Puis un jour on m’a dit "go west"
Alors j’ai pédalé
De New-York à Los Angeles
Sur un vélo volé
Alors j’ai usé des coudes
A frotter les comptoirs
Avec une étoile d'Hollywood
Qui perdait la mémoireLe long de Sunset Boulevard

Bras dessus, bras dessous
On perdait ses derniers dollars
Dans les machines à sous
Un jour Benjamin Shankar
Le cousin ou le frère
Du type qui joue du cithare
A la cour d'Angleterre
A gagné aux dés le droit
D’être un an, son amant
On est allé vivre à trois
Dans son appartement
Elle ramenait des voyageurs,
Des collégiens timides
Qui pouvaient faire deux dollars l'heure,
Quelques PolaroïdsElle nous mettait dans la cuisine
Pour ne pas qu’on regarde
En deux mois, on jouait tout Gershwin
Sur des verres à moutarde
On a fait du music hall
Déguisés en Hindou
Elle dansait en Baby Doll
Sur Rapsodie in blue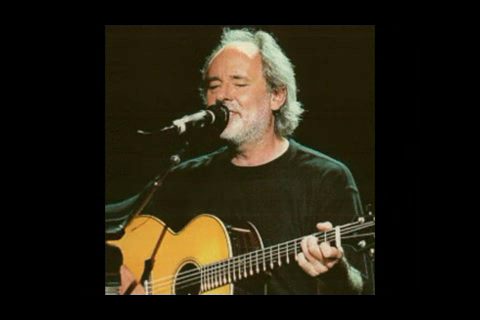
Elle a fini sous le capot
D'une Dodge ou Cadillac
J’ai ramassé son chapeau
Et l'autre a pris son sac
Puis il a continué
Sa vie d'Hindou errant
Moi, je suis retourné
Vivre chez mes parentsMa mère devenait trop laide
Pour jouer Jean Harlow
Mon père avait tué son aide
Au cirque à Buffalo…
Version Yves MONTAND en anglais :
02:12 Publié dans Chanson, Danse, Musique, Télérama, Vidéo | Lien permanent |
|  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |
15/09/2011
Libé–Interview Gérard Winter– “A la recherche du développement” (humain)
A l'occasion de la sortie du livre de mémoires de Gérard WINTER, Libé du 13 septembre 2011 proposait l'article et l'interview de 2002 qui suivent.
GÉRARD WINTER, RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT DU SUD
http://sciences.blogs.liberation.fr/home/2011/09/lautobio...
Comment le rejeton d’une famille tradi-catho, où la messe, l’entrée à Polytechnique et la carrière militaire sont la règle se vit un jour convoqué pour un interrogatoire inquisitoire par un ministre de la fonction publique le soupçonnant de trop grande proximité avec un militant du PCF. Et se demandant s’il fallait le virer de son poste de directeur adjoint de l’Institut international d’administration publique, aujourd’hui intégré à l’ENA.
Cette trajectoire fut celle de Gérard Winter, connu comme le loup blanc dans le monde de la recherche scientifique au service du développement du sud. Il en publie un récit autobiographique, complément utile et agréable à lire de son essai plus aride L’impatience des pauvres, paru aux PUF en 2002.
A cette occasion Libération publiait un entretien avec l’auteur où il définissait ainsi sa conception du développement:
« un parti pris en faveur de la lutte sociale et politique que mènent les plus démunis qui permettra l’avènement d’un développement plus solidaire. Et non l’imposition de modèles, venus d’en haut ou d’ailleurs, qui masquent mal les processus réels de concentration des bénéfices de la croissance, ou du moins leur contrôle, au profit des puissances dominantes.»
Bigre ! Subitement, on comprend la frousse du ministre. Tout l’intérêt du livre, dont la sincérité semble être la vertu cardinale, repose sur la description honnête d’une vie de «fonctionnaire au service d’une passion». Après l’X, la plupart de ses co-disciples s’envolaient vers les carrières à la recherche du pouvoir, de l’argent voire des deux. Galvanisé par la conférence d’un Père Jésuite sur le Tiers-Monde, Winter (photo à droite) se fait embaucher à l’ORSTOM (Office de la recherche scientifique et technique outre mer, aujourd'hui IRD).
Première mission : étudier l’alimentation et les budgets des familles d’une région de l’Amadoua, au Cameroun. Choc de la brousse. Découverte de l’incapacité de l’outil statistique métropolitain à rendre compte des réalités africaines puisque l'unité de compte - "le ménage avec papa, maman et les enfants" - n'a rien à voir avec la manière dont les familles gèrent leurs ressources et leurs dépenses.
De ce choc, Gérard Winter gardera tout au long de son activité le goût du "terrain" et la volonté de refuser dogmes et discours incontatoires. Le regard qu'il porte sur l'Afrique est particulièrement intéressant. On sent qu'il a entretenu un dialogue exigeant et amical avec ses collègues engagés à gauche, qui lui reprochaient probablement son refus de reprendre la condamnation du système capitaliste. On aurait aimé que la courtoisie et la retenue de Gérard Winter ne lui ait pas interdit de nommer nombre des personnalités rencontrées et de dresser des "portraits" - tant pour les responsables politiques, les hauts-fonctionnaires que pour les scientifiques qu'il a croisés. On aurait aimé lire son analyse du bilan de la direction qu'il qualifie de "syndicale" mise à la tête de l'IRD en 1982 par la gauche (à droite le Directeur général 1982-2007 Alain Ruellan, un pédologue de renommée internationale, militant de l'éducation populaire - voir ici la présentation de son dernier livre sur les sols) victime d'une campagne de presse de droite et d'extrême droite l'accusant d'avoir transformé l'IRD en officine révolutionnaire.
Gérard Winter ne lâche sa plume que pour condamner en termes vifs le fameux et malheureux "discours de Dakar" en 2007 de Nicolas Sarkozy reprochant à "l'Homme africain" de «n'être pas assez entré dans l'histoire». Ou pour fustiger l'action d'une direction de l'IRD mise en place par la droite. A l'inverse, le bilan équilibré qu'il fait des "plans" de développement des Etats d'Afrique francophone des années 1960 et 1970 est passionnant car il repose sur une expérience directe de cet effort.
Gérard Winter déploie une vision très politique du développement et de l'aide que peuvent apporter les pays industrialisés, qu'il décline en trois priorités (tirée d'une présentation récente) :
► «D’abord s’attacher à mettre en lumière les inégalités de toute nature qui, quand elles sont cumulées et excessives, deviennent injustes et bloquent toute initiative en faveur du développement. Actuellement ces inégalités sont mises au secret. Elles restent pratiquement un non-dit politique. Car il ne suffit pas de faire connaître statistiquement leurs caractéristiques et leur ampleur, encore faut-il analyser leurs causes profondes et leurs effets explosifs à long terme. La lutte contre la pauvreté débouchera tôt ou tard sur la lutte contre les inégalités et pour plus de justice, comme l’annoncent déjà les révoltes dans les pays arabes et ailleurs.»
► «Deuxième priorité à visée politique : Dans notre monde piloté par les sciences et les technologies, l’inégalité originelle est celle du savoir. Elle ne peut être réduite que par des politiques publiques d’éducation, de recherche scientifiques et de promotion de la culture scientifique des citoyens. Mais il ne suffit pas de transférer le savoir, il faut partager la capacité à apprendre et à découvrir. C’est pourquoi, nous avons voulu promouvoir à l’ORSTOM/IRD la recherche scientifique en partenariat avec les pays africains. Nous avons voulu, en quelque sorte, décoloniser la politique scientifique de l’ORSTOM. Ceci par des recherches décidées et menées d’un commun accord, avec des moyens, des bases scientifiques, des publications partagées.»
► «Pour lutter contre les inégalités, ces savoirs et savoir-faire doivent être mis aussi à disposition des plus pauvres, des sans-voix. Il faut renforcer leurs capacités (on dit maintenant capabilités) à analyser, s’organiser, défendre leurs intérêts, négocier en connaissance de cause. Ce fut là l’objectif, et c’est toujours l’objectif, de l’INTER-RESEAUX DEVELOPPEMENT RURAL que j’ai présidé pendant ses 6 premières années à la fin des années 90 aux côtés de Denis Pesche, son Secrétaire Exécutif. Il s’agissait d’aider les paysans africains à se constituer en groupements villageois, coopératives, institutions de micro-finance, puis en organisations paysannes, réseaux, syndicats leur permettant de devenir des acteurs incontournables de leur propre développement.»
Le regard critique qu'il porte sur l'action des ONG - «les interventions humanitaires dans l’urgence apprennent qu’elles seront conduites à se prolonger et à se multiplier indéfiniment si ne sont pas mises en place les conditions d’un développement sécurisé» - s'inscrit dans cette vision, non pour les décourager ou les stigmatiser, mais pour en marquer les limites.
Pour les internautes intéressés par l'action de l'IRD, je recommande la lecture de son journal "Science au sud", disponible gratuitement et téléchargeable ici sur son site web.
___________________________________
Voici ci-dessous le texte de son interview, toujours d'actualité dans ses grandes lignes, même s'il faudrait actualiser les chiffres, parue dans Libération en 2002, à l'occasion de son livre "L'impatience des pauvres".
Pour une lecture plus aisée, les pdf des pages sont ici pour la première et ici pour la seconde.
- Vous plaidez pour une voie de développement hétérodoxe,par opposition à une orthodoxie faite d’économie pure,déconnectée de la politique,aux mains de technocrates. Comment caractériser cette voie?
D’abord ,parce qu’elle privilégie le local, le long terme,le sociopolitique, alors que la voie orthodoxe s’appuie d’abord sur le national, le court terme, l’économique.
Puis par ce renversement: c’est d’abord un parti pris en faveur de la lutte sociale et politique que mènent les plus démunis qui permettra l’avènement d’un développement plus solidaire. Et non l’imposition de modèles, venus d’en haut ou d’ailleurs, qui masquent mal les processus réels de concentration des bénéfices de la croissance, ou du moins leur contrôle, au profit des puissances dominantes.
Loin de «l’option pour les plus pauvres» qui commence à faire slogan dans les agences de coopération, il s’agit d’un nouvel équilibre entre les forces du marché, les acteurs sociaux et un Etat de droit garant de l’intérêt commun et de l’équité.
Un Etat organisant une démocratie continue, aux divers niveaux de la société, doté de capacités d’arbitrage mais favorisant l’auto-organisation paysanne, la promotion des très petites entreprises, les initiatives collectives et décentralisées visant à créer des espaces de prospérité partagée.
Cette vision exige de reconsidérer l’aide internationale. Elle doit viser la réussite à long terme des réformes agraires, la réduction des inégalités sociales, la construction d’un système éducatif et de recherche scientifique, un aménagement du territoire soucieux de la préservation des capacités physiques et biologiques de l’environnement naturel.
A ces conditions, elle peut se combiner efficacement avec des mesures de court terme (fiscalité, ouverture extérieure, etc.).
Utopie? Je répondrais que l’utopie fait voir, sous l’apparence des choses, l’avenir au travail.
- Vous affirmez que le développement n’est pas une question de ressources naturelles, ni même d’argent. Mais alors que faut-il pour se développer?
L’ex-Zaïre aux immenses richesses naturelles ou le mauvais emploi des pétrodollars recyclés de 1974 à 1980 illustrent cette affirmation.
A l’inverse, au Japon, sans ressources naturelles et dont le développement fut endogène, les ouvriers ont un niveau de formation équivalent à notre bac.
Pour se développer, il faut d’abord et toujours une éducation de base généralisée et adaptée. Dans la plupart des pays en développement, à base rurale, il faut aussi promouvoir une agriculture performante qui assure sécurité alimentaire, revenus, devises et demande de produits manufacturés, mais une agriculture paysanne dont les revenus ne soient pas outrageusement ponctionnés par l’Etat et les citadins.
Les pays asiatiques, et en particulier la Corée du Sud, ont fait la démonstration de ce principe. Enfin, aucun développement n’est durable sans un Etat de droit garantissant un minimum de justice et de sécurité des initiatives privées. Même s’il n’implique pas un modèle transféré des pays occidentaux.
Bien sûr, tout cela ne s’applique qu’aux pays atteignant un seuil minimum de densité de population, de ressources naturelles, d’accès aux grandes voies de communication.
Combien des 195 Etats du monde ne remplissent pas ces conditions? Les pays lilliputiens, désertiques ou enclavés doivent s’intégrer dans des ensembles économiques et finalement politiques plus vastes et plus diversifiés. Un chemin long et difficile si on ne veut pas y dissoudre son identité et toute autonomie.
- S’il fallait dégager une priorité absolue pour le développement des pays les plus pauvres, quelle serait-elle?
Une formation de base pour tous les enfants. Un système éducatif adapté, c’est l’appropriation d’une culture, un investissement en matière grise dont dépendent toutes les autres formes d’investissement, une ouverture sur l’extérieur et l’apprentissage de savoir-faire dont dépendent emplois et revenus.
Le Japon, la Malaisie ou le Botswana, par des voies différentes, ont su relever ce défi.
Entre un système élitiste et un système trop axé sur des formations professionnelles élémentaires, il y a des formules originales à inventer, conciliant l’utilité à court terme et l’ouverture sur l’enseignement supérieur et la recherche.
Il y faut une volonté politique et un consensus social forts, un enseignement en langue locale les premières années, des enseignants bien formés et correctement rémunérés, ce à quoi peuvent contribuer les aides extérieures, si elles s’engagent sur dix ou vingt ans, ainsi que les nouvelles technologies de communication.
- Le dogme dominant stipule que les pays pauvres s’en sortiront en participant au commerce mondial libéré des barrières et taxes. Cette idée s’est-elle vérifiée?
Ils ne s’en sortiront pas seulement en ouvrant leurs frontières, ni en les ouvrant n’importe comment. Mais les réussites avérées en matière de croissance durable ne concernent que les pays qui ont accepté de multiplier, et surtout de diversifier, progressivement, leurs échanges avec l’extérieur, et donc leurs productions.
Tels sont les enseignements de l’histoire économique, qui mettent à bas tout dogme en la matière.
Corée du Sud et Malaisie ont su régler une participation croissante au commerce mondial, en se protégeant des importations concurrençant leurs nouvelles branches productives. Inversement, les pays d’Afrique subsaharienne ont, en gros, connu vingt ans de protection, puis vingt ans de démolition de leurs barrières douanières et monétaires sans pour autant connaître une croissance économique soutenue. L’Argentine, longtemps bon élève du FMI, connaît actuellement une crise dramatique.
La théorie libérale ne s’applique pas si les pays qui échangent ont des différences de productivité d’un à cent – c’est le cas entre les agricultures les plus riches et les plus pauvres –, si le commerce mondial est biaisé par oligopoles, spéculations, dumpings, subventions et protections plus ou moins déguisées.
Et la demande internationale ne suffit pas à elle seule à susciter des offres compétitives.
- Quel bilan peut-on tirer des «politiques d’ajustement» imposées par le FMI en échange d’un accès au crédit?
Elles étaient nécessaires: ni un pays, Etat ne peuvent vivre longtemps au-dessus de leurs moyens.
Mais elles ont été trop brutales, trop uniformes, trop globales.
Dans beaucoup de pays, il a fallu les répéter, preuve qu’elles ne s’attaquaient pas aux racines du mal.
A trop «compresser » les emplois et les salaires, donc les marchés intérieurs, à trop réduire l’Etat sans promouvoir l’Etat de droit, à privatiser sans saine concurrence, à ouvrir les frontières à des marchés biaisés par dumpings et subventions, elles ont découragé les initiatives.
Les investissements productifs, étrangers et nationaux, n’ont pas été au rendez-vous.
Il est plus facile et plus rapide de réduire la demande que de créer un tissu d’entreprises compétitives. Pauvretés, précarités et exclusions se sont accrues.
- L’Afrique, première cible de ces politiques, est-elle plus pauvre qu’il y a dix ans?
L’Afrique est immense et diverse: 750 millions d’habitants, plus grande que la Chine, l’Inde, l’Europe et les Etats-Unis réunis, 54 Etats, des dizaines de langues…
Il faut donc se garder de tout jugement global. Il est vrai, cependant, que la grande majorité des Africains ont vu leurs revenus baisser.
La Banque mondiale estime que le nombre de pauvres (vivant avec moins d’un dollar par jour) est passé de 217 à 291 millions en dix ans. Au-delà des statistiques, souvent incapables de décrire des situations qui échappent aux définitions occidentales et en particulier les échanges non-marchands , des signes d’appauvrissement ont clairement été identifiés en Afrique subsaharienne.
- Ainsi,l’augmentation du nombre de familles monoparentales dirigées par une femme, et d’enfants des rues.
- L’explosion des petits boulots urbains.
- Des jeunes diplômés qui préfèrent un emploi informel et bas de gamme à l’attente d’un emploi salarié.
- Le recul de l’accession à l’autonomie économique et au logement des jeunes adultes.
- L’augmentation des échanges non-monétaires entre ville et campagne.
- Celle de la violence urbaine et de la consommation de drogues…
- D’autres signes, comme la restriction des repas aux membres de la famille la plus proche ou l’essor des églises dites «du réveil» (sectes,groupes de prière) qui offrent de nouveaux modes de sociabilité, montrent une recomposition des liens sociaux.
- Pourtant,vous dénoncez paradoxalement une vision trop pessimiste de l’Afrique. Où se trouve le positif?
Malgré tout, des évolutions marquent des progrès décisifs dans la capacité des populations africaines à innover, à combattre par elles-mêmes les exclusions et les précarités, signes de la vraie pauvreté.
De nouvelles générations mieux formées, ouvertes sur le monde, sont en train d’investir tous les domaines de l’activité économique, sociale et politique.
- L’émancipation des femmes s’accélère sous la pression des contraintes de la survie familiale, et grâce à l’école.
- L’essor remarquable des formules de microfinancement leur doit beaucoup.
- Partout prolifèrent des associations,groupements villageois, comités de quartiers fondés sur la proximité géographique ou la solidarité professionnelle.
- Certains s’organisent en réseaux ou fédérations capables de peser sur les décisions politiques, comme le prouvent les organisations paysannes du Sénégal, du Mali, de Côte-d’Ivoire…
- L’économie populaire répond ingénieusement à de multiples besoins de la vie quotidienne et n’attend plus qu’une reconnaissance marquée par l’accès au crédit et à la formation professionnelle pour promouvoir un tissu de petites entreprises performantes.
- L’Internet rompt parfois l’isolement préjudiciable à l’information, à l’innovation et au regroupement de forces intellectuelles.
- Enfin, la démocratie s’enracine dans un mouvement de décentralisation tâtonnant mais irrépressible et original.
S’il n’est de richesse que d’hommes… et de femmes, alors oui, paradoxalement, l’Afrique s’enrichit. En outre, même si l’immense majorité des projets de développement ont des résultats mitigés et peu durables, obérés par la méconnaissance des obstacles dus aux comportements, aux clivages sociaux ou à la propriété foncière, certains succès montrent qu’il n’y a pas de malédiction africaine. Comme l’expansion de la culture du coton en Afrique francophone (100 000 tonnes en 1960, un million en 1998) ou le palmier à huile en Côte d’Ivoire, le recul décisif de la fièvre jaune ou l’éradication de la peste bovine en Afrique de l’Ouest et du centre.
- Y a-t-il contradiction entre les besoins immédiats du développement et le caractère durable de ce dernier?
Apparemment oui, inéluctablement non.
Comment empêcher la déforestation des hauts plateaux malgaches, facteur à moyen terme de stérilisation, quand une population croissante n’a pas d’autres sources d’énergie que le bois de chauffe et d’autres moyens de maintenir une production vivrière vitale qu’en défrichant de nouveaux espaces?
Faut-il restreindre la culture du coton, seule source de revenus monétaires au Sahel, quand la lutte contre l’épuisement des sols ne peut se conduire sans engrais, souvent trop onéreux pour concurrencer le coton subventionné aux Etats-Unis?
Il y a là une question vitale pour la grande majorité des pauvres.
Elle réclame des principes radicalement nouveaux en matière de développement, de relations internationales, d’aide publique et finalement de modes de consommation au Nord.
C’était l’enjeu majeur de la conférence de Johannesburg, dont les résultats ne sont malheureusement pas à la hauteur, même si elle a favorisé une prise de conscience et lancé quelques projets concrets.
L’aide durable et multiforme des pays riches doit contribuer à assurer la transition entre méthodes prédatrices de la nature et méthodes qui en renouvèlent le potentiel ou s’y substituent.
De nouveaux modes de production d’énergies renouvelables, d’utilisation de l’eau, des sols et des ressources biologiques sont en cours d’expérimentation dont il faut accélérer la mise au point et la généralisation.
Les populations du Nord-Cameroun ont ainsi réhabilité une variété traditionnelle de mil de saison sèche, ce qui a permis l’extension de la culture du coton.
La coopération française possède à son actif des exploitations durables de forêts qui associent entreprises forestières, villageois, fonctionnaires et techniciens.
Non, la contradiction évoquée n’est pas inéluctable.
__________________________________________________
Par Sylvestre Huet, le 13 septembre 2011
21:06 Publié dans Libé, Société et Justice | Lien permanent |
|  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |